La forêt rend une multitude de services essentiels à la société.
Elle régule le climat, protège les sols, purifie l’air et l’eau, stocke du carbone, fournit du bois, offre des paysages et des espaces de loisir. Ces services écosystémiques sont rendus possibles grâce au fonctionnement de l’écosystème forestier, notamment à travers la formation des sols, la décomposition des débris végétaux et animaux, la photosynthèse, l’évapotranspiration, etc. Ce fonctionnement de l’écosystème repose en partie sur la biodiversité, pilier de la résilience des milieux naturels. En effet, la richesse fonctionnelle de la biodiversité – au niveau des espèces, des écosystèmes, et des relations entre ces différents éléments – est souvent associée à une plus grande résilience face aux perturbations. Toutefois, la relation biodiversité-services n’est pas linéaire, et la perte de services écosystémiques peut être amplifiée par rapport à une perte de biodiversité. Les interactions sont nombreuses et le système complexe.
Des fonctions écologiques aux services écosystémiques
Les fonctions écologiques sont les processus biologiques qui permettent le fonctionnement et le maintien des écosystèmes (dimension écologique), tandis que les services écosystémiques sont les bénéfices que les hommes retirent de ces processus biologiques, autrement dit, ils en sont le résultat.
Les services écosystémiques sont généralement regroupés / classés en quatre catégories (Fig. 1) :
- Les services d’approvisionnement englobent tous les biens produits par l’écosystème : le bois et autres produits non-ligneux (fruits, noix, graines, champignons, fleurs, …), les animaux (gibiers, poissons), les ressources génétiques et pharmaceutiques (plantes médicinales), l’eau douce.
- Les services de régulation permettent de réguler les conditions environnementales telles que le climat (local et global), les inondations, les maladies et autres risques naturels (avalanches, chutes de blocs de pierre, glissements de terrain, érosion dunaire, etc.).
- Les services culturels correspondent aux bénéfices immatériels : activités récréatives (promenade, cueillette, observation de la nature) et sportives, expérimentation, éducation, cadre de vie, patrimoine identitaire, etc.
- Les services de support (ou de maintien) regroupent toutes les propriétés écosystémiques qui permettent la réalisation des trois autres catégories de services : cycle des nutriments, formation des sols, photosynthèse, etc.
Le changement climatique, via l’accroissement en fréquence et en intensité d’évènements climatiques extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses, incendies, tempêtes, inondations, …) et de dégâts liés aux pathogènes et ravageurs, altère le bon fonctionnement des écosystèmes forestiers, et donc la fourniture des services écosystémiques. Les études se multiplient pour identifier et mesurer les impacts de ces changements. Cet article en présente quelques exemples.
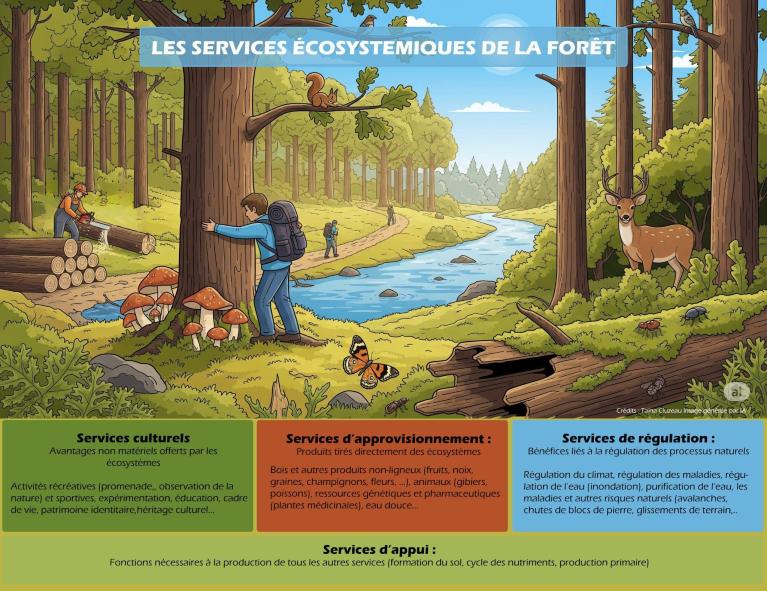
Crédit : Taïna Cluzeau, 2025.
-
Le changement climatique pourrait avoir un impact négatif sur la vie dans les sols, entraînant une perte des services écosystémiques liés aux champignons mycorhiziens tels qu’une diminution de la nutrition des arbres, du stockage de l'eau, de la décomposition de la matière organique et du recyclage des nutriments[1]. Cette altération des services de support aura des répercussions sur les autres services fournis par les forêts.
Pour en savoir plus
[1] Carles Castaño, Björn D. Lindahl, Josu G. Alday, Andreas Hagenbo, Juan Martínez de Aragón, Javier Parladé, Joan Pera, José Antonio Bonet, Soil microclimate changes affect soil fungal communities in a Mediterranean pine forest, New phytologist, Volume 220, Issue 4, Pages 1211-1221, December 2018.
-
Les effets positifs du changement climatique sur la croissance des arbres via l’allongement de la période de végétation, des apports en azote atmosphérique ou de la hausse du CO₂, sont aujourd’hui contrecarrés par l’augmentation du stress hydrique. Ce manque d’eau entraîne des baisses de croissance, voire des dépérissements, observés chez un nombre croissant d’espèces en milieux tempérés. En France, les suivis du Département de la Santé des Forêts (DSF) et les données de l’inventaire forestier national confirment une nette augmentation de la mortalité des arbres, en particulier depuis 2018, touchant la plupart des essences. Les résineux sont particulièrement concernés du fait de la crise « scolyte » qui touche désormais également les zones de montagne (Fig. 2). 95% des régions connaissent une baisse de la production en bois entre 1978 et 2022 (Fig. 3). Cette baisse de production est fortement corrélée aux impacts du changement climatique sur les écosystèmes forestiers.

Figure 2 : Évolution du taux d'arbres dépérissants entre 2010 et 2022 dans les cinq principaux massifs montagneux français. Estimé à partir des placettes de l'inventaire forestier, un arbre étant considéré dépérissant quand le taux de branches mortes dépasse 50 %. Effectifs moyens annuels par essences, en nombre d'arbres dominants ou codominants : Épicéa commun 2058, Pin sylvestre 1728, Sapin pectiné 2200, autres 2639 (Rodriguez, 2023).
Crédit : Piedallu, C. (2025). Impact du changement climatique sur les forêts. Partie 1 : État des lieux et conséquences. Revue forestière française, 75(4), 289–305.
Zoom sur l'image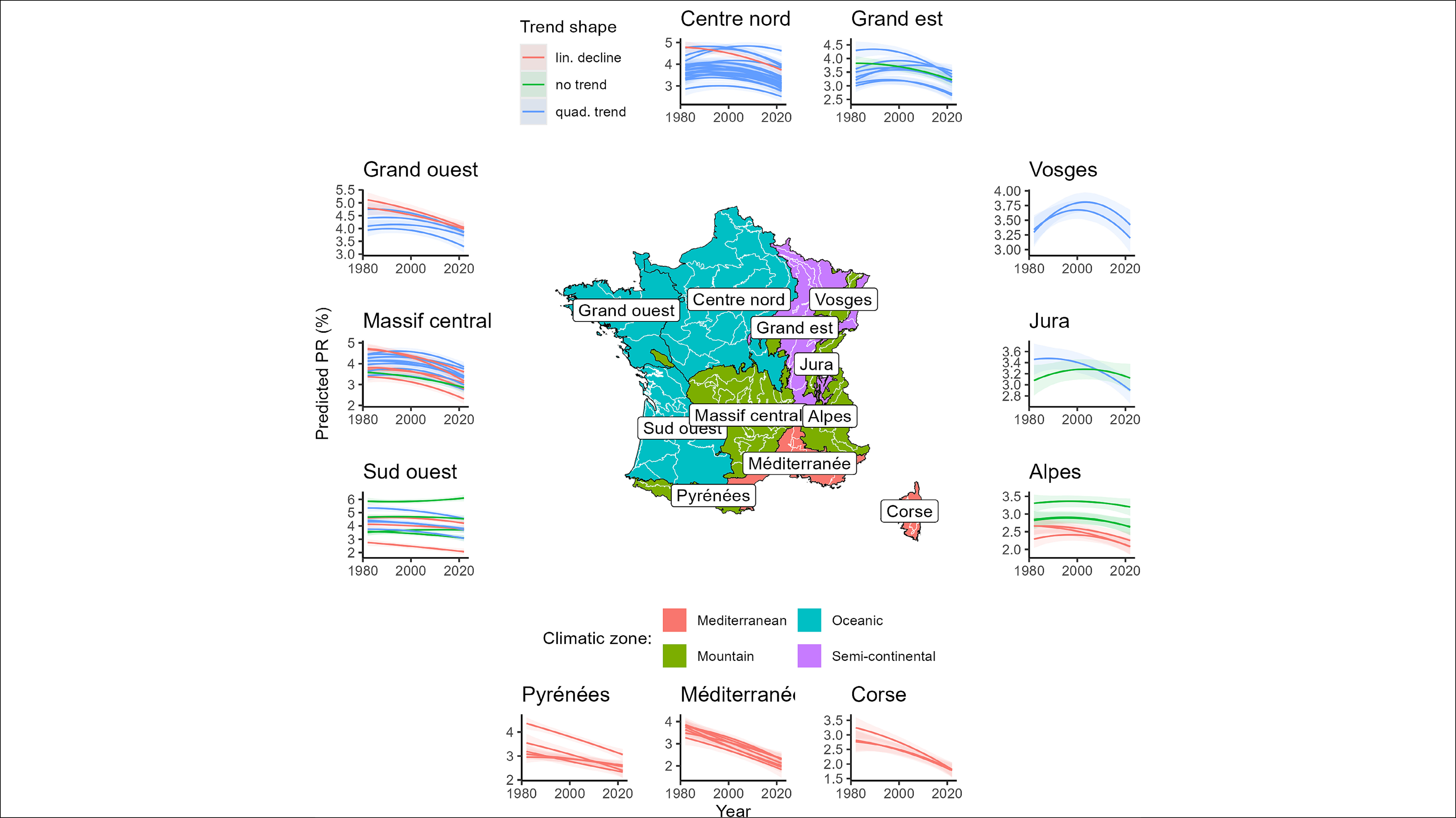
Figure 3 : Carte des 11 régions biogéographiques (contours noirs) et des 86 régions forestières (contours blancs). Les couleurs de remplissage représentent les zones climatiques associées aux régions biogéographiques. À l'extérieur : tendance du taux de productivité prédite par le modèle défini dans les équations (1), (2), (3) et (4) au niveau des régions forestières. Les lignes bleues indiquent des preuves substantielles d'un point d'inflexion (P(β2 < 0) > 0,9), tandis que les lignes rouges représentent des tendances linéaires (P(β1 < 0) > 0,9). Les lignes vertes indiquent les régions forestières pour lesquelles il n'existe aucune preuve substantielle d'une tendance temporelle (P(β2 < 0, β1 < 0) < 0,9). Les enveloppes correspondent aux intervalles de confiance à 90 % autour des tendances prévues.
Crédit : Lionel R. Hertzog, Christian Piedallu, François Lebourgeois, Olivier Bouriaud, Jean-Daniel Bontemps, Turning point in the productivity of western European forests associated with a climate change footprint, Science of The Total Environment, 2025.
Zoom sur l'imageLes effets attendus du changement climatique sur l'arbre et la forêt
-
Le ralentissement de la croissance des arbres et l’augmentation de leur mortalité réduit la disponibilité de bois exploitable. Sur la période 2014-2022, le bilan net des flux de bois[2] a chuté de 53 % par rapport à la décennie précédente (2005-2013). En 2023, la récolte commercialisée en France métropolitaine s’établit à 39,1 millions de m³, dont près de 9 % proviennent de coupes sanitaires ou accidentelles, principalement liées aux attaques de scolytes[3].
L’afflux massif de bois dégradé, difficile à valoriser, provoque l’effondrement des prix de certaines essences. L’épicéa, par exemple, connaît des chutes brutales de valeur dans les régions touchées. En parallèle, l’approvisionnement en graines d’espèces adaptées au climat futur devient critique : les stocks diminuent et les prix explosent, notamment pour les essences recherchées dans les stratégies d’adaptation.
Par ailleurs, les risques d’accidents chez les travailleurs forestiers s'accentuent (chutes d’arbres suite aux dépérissements et aux tempêtes) et les épisodes de canicule rendent le port des équipements de sécurité éprouvant. Des conditions qui, s’ajoutant à un travail forestier souvent mal rémunéré, découragent les vocations. Or, le manque de main-d'œuvre qualifiée limite la capacité de reconstitution des peuplements après crise. De plus, les périodes d’exploitation se restreignent, encadrées par les réglementations de prévention des incendies ou de protection de la biodiversité, ce qui complique aussi l’organisation des chantiers.Pour en savoir plus
[2] + 19,5 Mm3/an (production biologique - mortalité - prélèvements)
[3] Agreste Récolte de bois et production de sciages en 2023
-
Le service de régulation du climat intervient à différents niveaux (Ademe, 2020) :
- Les forêts jouent un rôle de réservoir de carbone, grâce aux différents compartiments interconnectés : la biomasse aérienne et souterraine, le bois mort, la litière, la matière organique des sols et les produits bois.
- Du fait de l’augmentation des stocks dans le réservoir forestier, les forêts jouent également un rôle de puits de carbone. C’est l’expansion en surface des forêts françaises, couplée à l’augmentation du stock de bois sur pied, qui permet ce rôle de puits à l’échelle nationale.
- Enfin, les forêts ont un rôle de réduction des émissions d’origine fossile grâce à l’utilisation du bois en substitution d’autres matériaux (acier, ciment, etc.) ou énergies (charbon, pétrole, gaz, etc.), davantage consommateurs ou émetteurs de carbone fossile : on parle d’effets de substitution. Ces effets sont directement liés à l’approvisionnement en bois, ainsi qu’à la capacité de la filière à maximiser la durée de vie des produits.
Le secteur forêt-bois est donc stratégique pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 : à la fois pour réduire les émissions de GES d’origine fossile grâce à la bioéconomie liée au bois (notamment dans les secteurs du bâtiment et de l'énergie) et pour séquestrer les émissions résiduelles dans l’écosystème (Fig. 4).
En raison du changement climatique, le maintien de la capacité même des forêts à stocker du CO2 atmosphérique fait actuellement débat et de fortes incertitudes existent, pouvant remettre en cause la nature même du puits de carbone forestier à l’échelle de la planète (Fady et al., 2021). En France, le puits de carbone forestier a été divisé par deux en 10 ans (CITEPA, 2023), et les simulations pour les périodes futures suggèrent une aggravation de la situation (IGN-FCBA, 2024). À titre d’exemple, les forêts de certaines régions, comme le Grand-Est, sont passées ponctuellement de puits à source de carbone en raison de la crise des scolytes sur les épicéas (CITEPA, 2023).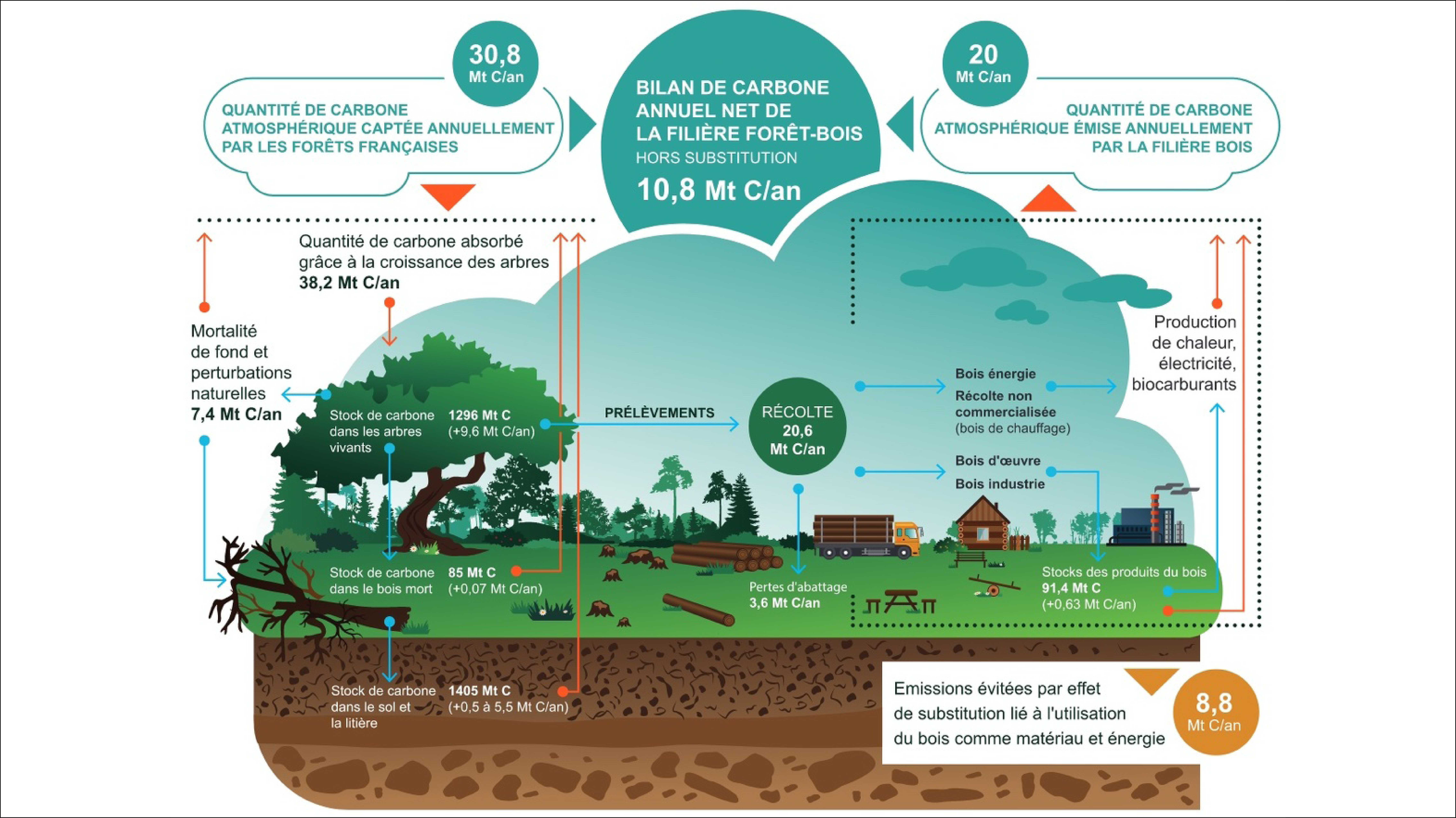
Figure 4 : Bilan de carbone des écosystèmes forestiers (à gauche) et des produits du bois (à droite) pour le territoire métropolitain. Les flux et les stocks sont exprimés en Mt C/an. Une variation annuelle de stock de 1 t C / an correspond à 3,664 t CO2/an. La forêt a séquestré de façon nette, en moyenne sur 2015-2020, 10,2 Mt C/an (30,8 Mt C captés par la croissance moins 20,6 Mt C récolté) soit 37,4 Mt CO2/an. L'ensemble de la filière forêt et bois a séquestré de façon nette 10,8 Mt C/an (10,2 Mt C dans la forêt et 0,6 Mt C dans les produits bois) soit 39,6 Mt CO2/an.
Crédit : Les forêts françaises face au changement climatique, Rapport du Comité des sciences de l’environnement de l’Académie des sciences et points de vue d’Académiciens de l’Académie d’Agriculture de France - juin 2023.
Zoom sur l'image -
L’accroissement des aléas naturels (incendies, tempêtes) conduit à limiter - voire à interdire - l’accès aux forêts, surtout en été. À cela s’ajoute la dégradation du paysage forestier, causée par les dépérissements, les coupes sanitaires ou les incendies. Dans ce contexte, le rôle social de la forêt, comme espace de loisir, de détente ou de lien avec la nature, se trouve à la fois mis en lumière, et en même temps fragilisé. Ces pertes ne sont pas quantifiables économiquement aussi facilement que celles liées à la production de bois. Cependant, une analyse fondée sur les coûts de déplacement engagés par les visiteurs permet d’estimer la valeur totale que la population accorde à l’accès aux forêts françaises entre 13 et 45 milliards d’euros par an selon les hypothèses retenues (Efese, 2020), soit bien au-delà de la valeur marchande du bois récolté (2,83 milliards d’euros en 2018, source BETA-OLEF). Les impacts économiques d’une baisse de la qualité paysagère et de la sécurité d’accès aux forêts, bien que non estimables, ne sont pas sans effets. Ceux-ci peuvent par exemple se manifester indirectement par des incompréhensions croissantes de l’action des forestiers par la société.
Cette valeur récréative varie en fonction de plusieurs facteurs : la possibilité d’observer certaines espèces emblématiques de la faune sauvage, la possibilité de cueillette de champignons, et la présence de chemins balisés, ainsi que d’autres caractéristiques plus directement liées à la gestion forestière - comme la hauteur des arbres et la diversité des essences -, à l’accessibilité du territoire et au type de propriété de la forêt (publique ou privée). Dans les zones les plus fréquentées, elle peut atteindre plus de 37 000 euros par hectare, contre environ 10 euros dans les forêts éloignées des agglomérations urbaines et dans les zones densément boisées.
Des incertitudes sur les effets du changement climatique sur les services écosystémiques
De nombreuses lacunes de connaissances persistent sur la manière dont le vivant est affecté par le changement climatique et sur les capacités d’adaptation. En particulier, l’impact de la biodiversité — qu’il s’agisse de la composition des espèces ou du fonctionnement des écosystèmes — sur les services écosystémiques reste largement non quantifié. Cela s’explique par l’absence de modèles capables de représenter les interactions complexes entre climat, espèces et usages (IPBES, 2019).
Les études concordent cependant pour indiquer que le changement climatique impacte déjà la croissance et la mortalité des arbres. L’évolution future telle que dessinée dans les scénarios du GIEC pour les décennies à venir risque de conduire à une nette dégradation de l’état des écosystèmes forestiers ainsi que les services qui y sont liés, avec un possible caractère irréversible de ces changements. La mise en place des solutions d’adaptation devra intégrer une multitude d’enjeux et de risques à différents niveaux, de l’arbre au peuplement et aux massifs forestiers, tout en prenant en compte les impacts sur l’économie, sur le climat et sur la société. C’est à ce prix que nous pourrons continuer à bénéficier des nombreux services rendus par la forêt sur notre qualité de vie.
Bibliographie
Articles scientifiques
- Bastit, F., Riviere, M., Lobianco, A., & Delacote, P. (2024). Prospective impacts of windstorm risk on carbon sinks and the forestry sector: an integrated assessment with Monte Carlo simulations. Environmental Research Letters.
- Castaño, C., Lindahl, B. D., Alday, J. G., Hagenbo, A., Martínez de Aragón, J., Parladé, J., Pera, J., & Bonet, J. A. (2018). Soil microclimate changes affect soil fungal communities in a Mediterranean pine forest. New Phytologist, 220(4), 1211–1221.
- Fady, B., Davi, H., Martin-StPaul, N., & Ruffault, J. (2021). Caution needed with the EU forest plantation strategy for offsetting carbon emissions. New Forests, 52(5), 733–735.
- Patacca, M., Lindner, M., Lucas-Borja, M. E., Cordonnier, T., Fidej, G., Gardiner, B., Hauf, Y., Jasinevičius, G., Labonne, S., Linkevičius, E., Mahnken, M., Milanovic, S., Nabuurs, G.-J., Nagel, T. A., Nikinmaa, L., Panyatov, M., Bercak, R., Seidl, R., Ostrogović Sever, M. Z., ... & Schelhaas, M.-J. (2023). Significant increase in natural disturbance impacts on European forests since 1950. Global Change Biology, 29, 1359–1376.
- Piedallu, C. (2025). Impact du changement climatique sur les forêts. Partie 1 : État des lieux et conséquences. Revue forestière française, 75(4), 289–305.
Rapports, ouvrages et documents institutionnels
- Agreste. (2025). Récolte de bois et production de sciage en 2023.
- Citepa, 2023. Gaz à effet de serre et polluants atmosphériques. Bilan des émissions en France de 1990 à 2022. Rapport Secten éd. 2023.
- Bastick, C., Colin, A., Cuny, H., Bailly, A., Berthelot, A., Chaumet, M., Deroubaix, G., Lahiani, M., Ruch, P., Savagner, L., & Vial, E. (2024). Projections des disponibilités en bois et des stocks et flux de carbone du secteur forestier français. IGN – FCBA.
- Efese. (2018). Les écosystèmes forestiers. Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques.
- Efese. (2020). Les usages récréatifs des forêts métropolitaines.
- Fondation pour la recherche sur la biodiversité. (2023). Biodiversité et changement climatique : impacts sur la biodiversité, les écosystèmes français et les services écosystémiques. Recommandations pour l’adaptation de la biodiversité. Synthèse de connaissances. (Soubelet et al.)
- GIP ECOFOR & Ministère de la Transition écologique. (2022). Programme de recherche « Biodiversité et gestion forestière » : bilan 1996–2018. (Picard, N., Appora, V., & Landmann, G.)
- Observatoire des forêts françaises. (2024). Mieux connaître les forêts françaises : résultats 2024 de l’inventaire forestier, nouvelles technologies de connaissance (IA, LiDAR…), étude Forêt Carbone 2050.
- Académie des sciences & Académie d’agriculture de France. (2023). Les forêts françaises face au changement climatique. Rapport du Comité des sciences de l’environnement et points de vue d’Académiciens.
Experts interrogés
- Claire Bastick, IGN
- Ingrid Bonhême, IGN
- Elodie Brahic, INRAE
- Nicolas Picard, Gip Ecofor
- Simon Martel, I4CE
- Tammouz Enaut Helou, Coopératives
- François-Xavier Saintonge, DSF
Description et crédits de l'image d'en tête : Journées Intercetef 2013 : valoriser les services écosystémiques (carbone, champignons, eau potable) - Thonon-les-Bains : paysage de forêt en Rhône-Alpes. Patrick Rey - CRPF Aquitaine © CNPF

