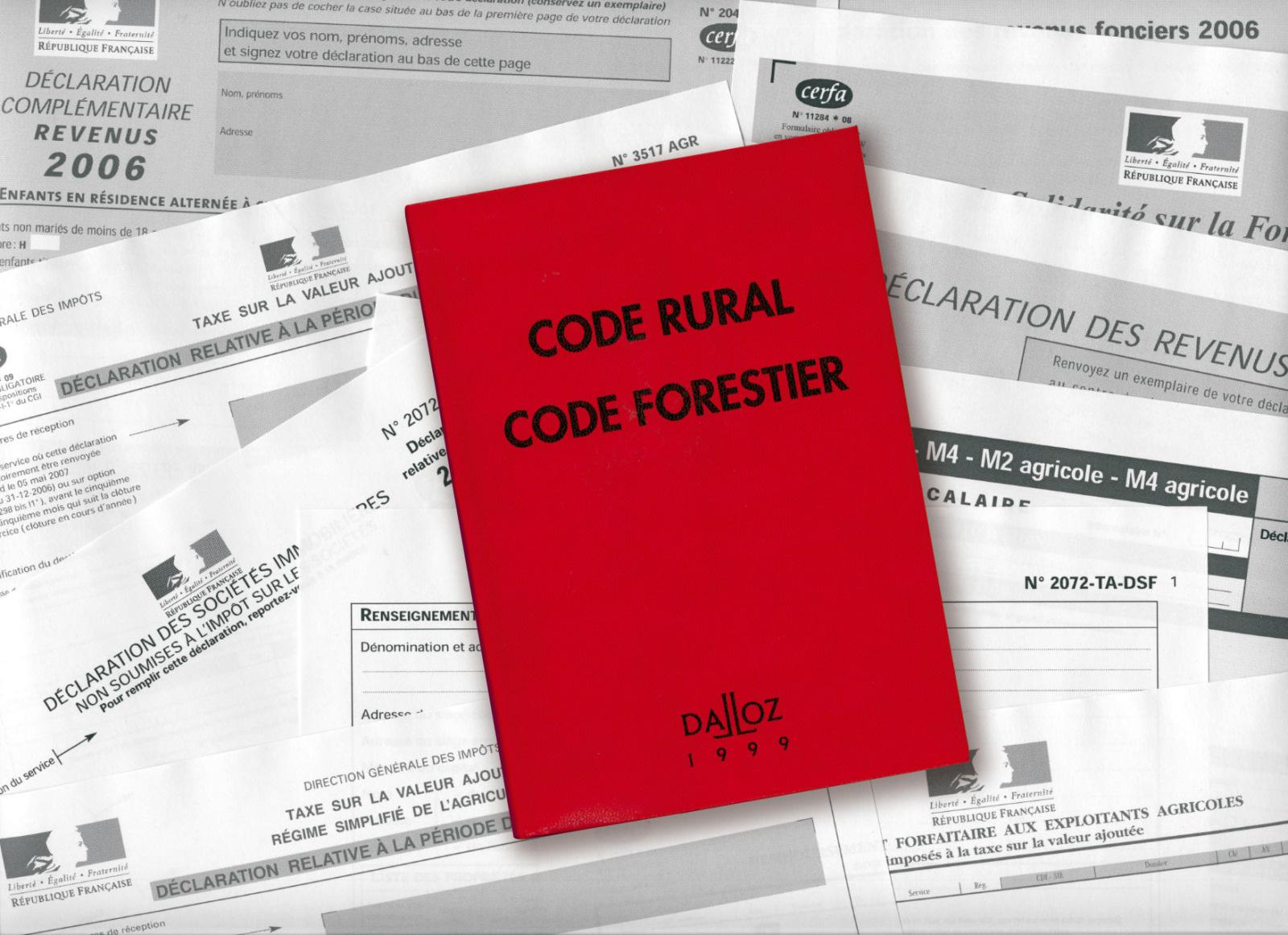Face au changement climatique, les politiques forestières s’appuient sur un ensemble de textes, stratégies et politiques publiques, tant à l’échelle internationale et européenne que nationale voire même avec des déclinaisons régionales. Ces documents fixent des cadres et objectifs de long terme et orientent la mise en œuvre d’outils réglementaires et dispositifs d’aides publiques.
Les grandes orientations internationales : les conventions de Rio et les Objectifs de développement durable
Pour répondre aux défis du changement climatique, de la désertification et de la perte de biodiversité étroitement liés, les gouvernements ont fondé trois « Conventions de Rio » lors du Sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro, au Brésil :
- La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ;
- La Convention sur la diversité biologique (CDB) ;
- La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD).
Ces trois conventions sont le résultat d’une réponse aux préoccupations environnementales et ont le développement durable au cœur de leurs actions. Parmi les objectifs fixés par ces conventions, la CCNUCC a déterminé, avec l’Accord de Paris en 2015, l’objectif de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Les accords de Paris renforcent la prise en compte de l’adaptation au changement climatique, notamment dans les Contributions Déterminées Nationales (CDN) soumises par les Etats tous les 5 ans et qui peuvent contenir un volet adaptation.
En parallèle, les Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable (ODD) en 2019. Ils doivent permettre de répondre aux défis mondiaux auxquels est confrontée l’espèce humaine, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.
Le pacte vert ou Green deal : un cadre européen structurant
Dans le prolongement des élections européennes de 2019, le Pacte vert (ou « Green deal ») est lancé par la présidente de la Commission Ursula Von Der Leyen lors de son premier mandat (2019-2024). Il est défini comme "la nouvelle stratégie de croissance" de l'UE destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre, "tout en créant des emplois et en améliorant notre qualité de vie".
Plus précisément, le Pacte vert est un ensemble de politiques qui visent notamment à concrétiser les engagements de l'UE sur la scène internationale en matière de climat. L'objectif principal du Pacte vert est que l'Europe parvienne à la neutralité climatique à l'horizon 2050. Cet objectif a été repris dans la loi européenne sur le climat adoptée en juin 2021. En plus de la neutralité climatique, cette loi prévoit le renforcement des puits de carbone, notamment forestier.
Seconde grande étape du Pacte vert, l'exécutif européen a présenté en juillet 2021 un ensemble de propositions afin d'aligner les politiques et la législation de l'UE sur l'objectif de neutralité climatique, en fixant un objectif intermédiaire de réduction des émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Ce paquet appelé "Ajustement à l'objectif 55", ou "Fit for 55", comprend une série de mesures, notamment sur les énergies renouvelables et sur la comptabilité des absorptions carbone (LULUCF).
En complément, la Commission a publié en 2021 plusieurs feuilles de route sectorielles, dont la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à horizon 2030, la stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 et la stratégie de l’UE pour l’adaptation au changement climatique avec l’ambition de « Bâtir une Europe résiliente », suivant quatre axes :
- Une adaptation plus intelligente : améliorer les connaissances et gérer l’incertitude ;
- Une adaptation plus systémique : soutenir l’élaboration de politiques à tous les niveaux et dans tous les secteurs ;
- Une adaptation plus rapide : accélérer l’adaptation dans tous les domaines ;
- Intensifier l’action internationale en faveur de la résilience face au changement climatique.
D’autres réglementations ont été adoptées comme le cadre européen de certification des absorptions carbone, le règlement sur la restauration de la Nature ou le règlement de lutte contre la Déforestation et la Dégradation des forêts. Ces règlements, publiés après 2021, viennent renforcer le pacte vert.
Suite aux élections européennes de 2024 et la reconduction d’Ursula Von Der Leyen comme Présidente de la Commission (2024-2029), un nouveau projet de mandat a été adopté qui intègre entre autres l’élaboration d’un plan européen d’adaptation au changement climatique.
Sur le plan scientifique, l’UE a lancé Horizon Europe (2021-2027), programme-cadre de recherche de l’UE qui prend la suite de Horizon 2020. Un partenariat européen de recherche et d’innovation sur les forêts sera lancé dans ce contexte pour la période 2025-2031, rassemblant des équipes de plusieurs pays autour de projets définis collectivement. Doté de 230 millions d’euros apportés par la Commission, ce programme doit être validé d’ici septembre 2025.
La déclinaison française
En 2019, la France adopte la loi Énergie-climat qui inscrit l’objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre à l’urgence climatique et à l’Accord de Paris. Puis en août 2021, la loi "Climat et Résilience" est adoptée qui traduit une partie des146 propositions issues de la Convention citoyenne sur le climat (2019) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale.
Puis pour répondre au pacte vert, la France élabore en 2023 la Stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC), composée de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC-3), de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE-3), et du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3). Les forêts y apparaissent comme un secteur essentiel, autant pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (atténuation) que comme un secteur prioritaire pour l’adaptation au regard des impacts du changement climatique sur ces dernières.
Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3) publié le 10 mars 2025 vise à lutter de manière globale contre le réchauffement climatique et anticipe une hausse des températures de 4 degrés à l’horizon 2100. La France s’est dotée pour la première fois d’une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC). La TRACC est définie à partir du scénario tendanciel d’après le GIEC et doit servir de référence à toutes les actions d’adaptation menées en France. Au sein du PNACC-3, une mesure (et 15 actions) est dédiée aux forêts et prévoit notamment :
- L’élaboration d’une stratégie nationale d’adaptation des forêts au changement climatique ;
- Le prolongement du financement du RMT AFORCE ;
- La mise à jour selon la TRACC et le déploiement des outils sylvoclimatiques à grande échelle (Bioclimsol, Climessences, etc.).
La politique forestière proprement dite s’appuie sur le Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB) introduit par la Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014, qui fixe les orientations en forêts publique et privée, en métropole et en outre-mer, pour une période de dix ans (2016-2026). Il s’articule autour de 4 objectifs :
- Créer de la valeur en France, en mobilisant la ressource durablement ;
- Répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer aux projets de territoires ;
- Conjuguer atténuation et adaptation des forêts au changement climatique ;
- Développer des synergies entre forêt et industrie.
Il est issu d'une large concertation avec l'ensemble des parties prenantes de la filière forêt-bois et en cours de révision pour la période 2026-2036. À cela, s’ajoute la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique élaborée par les parties prenantes en 2019-2020. Celle-ci a été reprise lors des Assises de la forêt et du bois qui se sont tenues entre octobre 2021 et mars 2022 et qui ont abouti à un plan d’action ambitieux de 25 mesures, dont la mise en place par le RMT AFORCE d’un appel à projets sur l’adaptation des forêts au changement climatique.
En complément et face à la hausse des dépérissements et de la mortalité, la Forêt a fait l’objet d’aides de l’Etat pour le renouvellement forestier, que ce soit à travers France Relance ou France 2030. Depuis 2024, cette aide a été prolongée dans le cadre de la Planification écologique France Nation Verte, sous la forme d’un guichet pérenne d’aides au renouvellement forestier. Les besoins en renouvellement ont été chiffrés entre 1,5 à 1,7 Mha en 10 ans (rapport « Objectif Forêt), soit 10 % de la surface forestière hexagonale. Cette estimation des surfaces à renouveler dans un objectif d’adaptation s’ajoute aux 0,5 Mha de renouvellement prévus dans le cadre de la gestion courante des 10 prochaines années. Au-delà de ces investissements nécessaires, une analyse publiée par I4CE en 2022 insistait sur l’importance de donner aux acteurs de la filière les moyens de faire les bons choix et de maintenir des moyens humains pour l’opérationnalisation des stratégies d’adaptation (I4CE, 2022).
Enfin, suite aux incendies exceptionnels de l’été 2022, par leur ampleur et leur durée, une nouvelle loi a été adoptée le 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Le 5 juin 2025, une stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies a été signée par le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. Celle-ci doit permettre de mieux coordonner les actions de prévention des risques, de gestion de crise et d'aménagement, notamment en maîtrisant mieux l'urbanisation. Le PNACC-3 (présenté précédemment) intègre également une mesure dédiée à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation, assortie de plusieurs actions visant à :
- Améliorer la défense des forêts contre les incendies ;
- Prévenir les risques et protéger les territoires situés à l’interface entre massifs boisés ou végétalisés et zones bâties (où naissent de nombreux feux) ;
- Préparer les services de l’État dans les départements historiquement moins confrontés aux feux de forêt que ceux du sud de l’Hexagone.
Un ancrage régional indispensable
Les Programmes Régionaux de la Forêt et du Bois (PRFB) traduisent localement les objectifs nationaux du PNFB. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs actions concrètes ont été mises en œuvre :
- Le lancement en mars 2021 par la DRAAF d’un groupe de travail régional « Forêt et changements climatiques » avec un plan d’action dédié, qui a notamment débouché sur l’organisation de webinaires mensuels de partage de la connaissance sur ce sujet, ou encore le financement par la DRAAF de travaux de recherche & développement en matière de sylviculture adaptative, menés par le CNPF et l’ONF ;
- L’introduction de nouvelles essences d’accompagnement dans l’arrêté préfectoral des matériels forestiers de reproduction ;
- L’organisation d’un colloque par Fibois sur l’utilisation du feuillu dans le bâtiment et les aménagements extérieurs, ainsi que le financement notamment par l’ANCT de travaux pour valoriser le châtaignier local.
En 2022, le Gouvernement a lancé la « Planification écologique », qui a comme objectif d’accélérer la transition écologique et la baisse des émissions de gaz à effet de serre de la France d’ici à 2030. Le plan d’action est structuré en 6 thématiques, dont la forêt. Les travaux ont été déclinés à l’échelle des régions et des départements, donnant ainsi lieu à des plans d’action régionaux. Par exemple, toujours en Auvergne-Rhône-Alpes, le volet forestier de la Planification écologique est structuré en 3 défis :
Défi 1 : Conforter / Restaurer le puits de carbone forestier – Adapter la gestion de nos forêts au changement climatique ;
Défi 2 : Renforcer la capacité à stocker du carbone dans les produits Bois au niveau régional ;
Défi 3 : Gérer les risques (sanitaires, incendies, tempête, …).
Face aux défis posés par le changement climatique, la forêt se trouve ainsi au cœur des stratégies d'adaptation et de résilience. Les politiques européennes, nationales et régionales convergent pour promouvoir une gestion durable, préserver la biodiversité et la fonction de puits de carbone et soutenir la filière bois. La réussite de ces initiatives repose sur une coordination efficace entre les différents niveaux de gouvernance et une adaptation aux spécificités locales. Ainsi, la forêt devient un acteur central de la transition écologique, alliant protection de l'environnement et développement économique.
Tableau : aperçu des principales stratégies et règlementations qui concourent à définir le cadre global de l’adaptation des forêts au changement climatique et à resituer ces dernières au carrefour de nombreuses politiques sectorielles nécessitant une mise en cohérence globale, à l’échelle européenne et nationale.
| Thématique | Stratégies européennes | Règlementations européennes | Stratégies françaises | Règlementations françaises | Instruments/outils français |
|---|---|---|---|---|---|
| Climat |
|
- Règlement LULUCF (2018, révisé en 2023). -Règlement établissant le cadre européen sur les absorptions de carbone (2024). |
|
|
|
| Biodiversité |
|
|
|
|
|
| Gestion forestière |
|
|
|
|
|
| Sols |
|
|
|
|
|
| Recherche |
|
|
|
|
Experts interrogés
- Adeline Favrel, Ministère de la Transition écologique
- Magali Maire, Gip Ecofor
- Simon Martel, I4CE
- Isabelle Ménard, DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
- Nicolas Picard, Gip Ecofor
- Jonathan Stemmelen, Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire
Description et crédits de l'image d'en tête : Illustration stage fiscalité IDF. Florent Gallois © CNPF